Au XIXe siècle, la féminisation du métier devient de plus en plus fréquente. Or cette situation est alors très peu évoquée. Le règlement des gardiens de 1889, pour la première fois, officialise la situation. « Le service des feux d’importance secondaire ou placés dans des conditions spéciales peut être confié par abonnement à des personnes qui ne sont pas classées parmi les gardiens de phares ; ces emplois peuvent être occupés par des femmes choisies de préférence parmi les veuves des agents de l’administration. » Les archives nous prouvent avec certitude que les femmes sont de plus en plus nombreuses après cette date : la nomination de gardienne « hors-classe » est pratiquement systématique pour remplacer des gardiens « classés » partant en retraite. En 1919, le règlement se précise : « Dans les postes confiés simultanément à un gardien classé et à une gardienne hors-classe, celle-ci ne peut être que la femme, la mère, la fille ou la sœur du gardien classé. Dans ce cas, le service habituel et obligatoire de cette gardienne hors-classe consiste à coopérer avec le gardien classé au service de l’éclairage et à le remplacer complètement pour ce service en cas d’empêchement accidentel ou pendant ses périodes de repos. »
Un statut bien fragile
Ces femmes tiennent leur rôle sans aucun problème et remplacent même avantageusement les hommes : en effet, pour le Service, ces auxiliaires sont précieuses à plus d’un titre, car leur salaire reste toujours inférieur à celui des agents classés. De plus, les ingénieurs du service des Phares, dans la majorité des cas, n’ont jamais « à se plaindre de leur penchant pour la boisson ce qui n’est pas le cas de nombreux gardiens de notre arrondissement », comme le souligne en 1908 l’ingénieur en chef de Quimper, Henri Willotte. De plus, hors du cadre général de la fonction publique, elles ne sont pas fonctionnaires, ne touchent pas de pension de retraite et dont licenciables à merci. La présence d’une femme dans une maison-phare est considérée comme un gage de fiabilité : les ingénieurs de l’époque considèrent en effet qu’une femme est beaucoup plus apte à tenir son intérieur qu’un homme. D’ailleurs, les gardiens célibataires sont systématiquement écartés des petits phares, où il convient, d’après M. Reynaud, directeur du service des Phares et Balises, de placer autant que possible des hommes mariés.
La toute première femme nommée trois ans avant la publication du nouveau règlement de 1889 s’appelle Marie-Perrine Durand. Veuve d’un gardien décédé en service, elle est chargée, en 1886, de l’allumage du phare du Rosédo sur l’île de Bréhat. Elle est engagée sous forme d’abonnement, un statut peu avantageux, renouvelé tous les ans jusqu’en 1889.
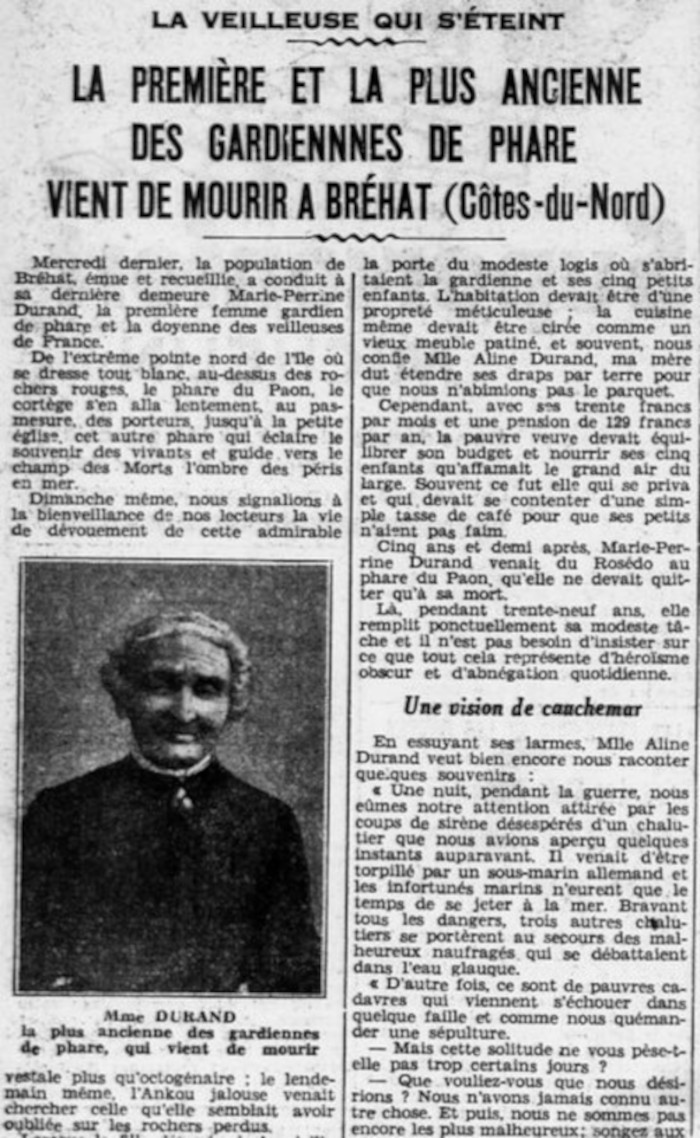
La seconde, Marie-Perrine Messager, remplace son mari décédé au phare de Pontusval dans le Finistère le 8 décembre 1889 et connaît parfaitement le fonctionnement de l’appareil. Elle est nommée gardienne hors-classe et reste en poste jusqu’en 1910 car, alors âgée de 76 ans, elle éprouve quelques difficultés pour assurer son service ; sa fille, Joséphine Perrot, la remplace ; mariée elle aussi à un gardien, elle le suivra au phare de Kermorvan quelques années plus tard. C’est sous cette forme de couple que l’on rencontre le plus souvent les auxiliaires féminines, comme ce fut le cas sans doute pour la première fois dans l’histoire du Service au phare de Lost-Pic dans les Côtes-du-Nord, allumé en août 1894. Un an plus tard, au phare des Moutons, aux Glénan, le chef gardien Donnart venait d’être admis, en février 1895, à faire valoir ses droits à la retraite, et pour le remplacer, l’ingénieur en chef propose de nommer sur l’île Henri-Noël Colin et sa femme. « Dans ces circonstances, nous avons pensé qu’il serait peut-être possible de réduire l’importance du personnel sans compromettre le service de l’éclairage […]. En remplaçant l’un des gardiens par un abonnataire payé 360 francs par an, on réaliserait une économie annuelle de 440 francs. Cette combinaison a été employée avec succès dans quelques phares en mer. Nous l’avons vue fonctionner à Lost-Pic près de Paimpol. » Le poste de second gardien est donc supprimé en 1895. À cette date, est nommée gardienne hors-classe la femme d’Henri-Noël Colin, Marie-Catherine née Goyat. Usée par le travail, elle doit quitter l’île pour recevoir des soins à terre. Alors sa fille, Joséphine, la remplace. En 1900, cette dernière démissionne remplacée par une autre femme, Jeanne-Marie Larsonneur, qui n’est autre que la seconde fille d’Henri et Marie Colin ! Cette façon d’opérer se généralise dans tous les départements maritimes dès que l’occasion le permet. Ainsi, Martien Bontonnou est nommé dans le Finistère en 1902 et termine sa carrière aux phares d’Audierne. Admis à faire valoir ses droits à la retraite en janvier 1930, il meurt quelques jours avant, le 9 décembre 1929. Sa veuve et ses enfants demandent un secours rapide pour assurer la survie de la famille. En fait, l’ingénieur préfère nommer la mère et la fille aînée qui assurent déjà l’allumage et la surveillance depuis de longs mois, car le père et mari était dans un état maladif incompatible avec le service.
L’obtention tardive du statut de titulaire
Le service des Phares nomme systématiquement des couples mariés pour remplacer les gardiens classés mutés, démissionnaires ou retraités. De cette manière, il économise un salaire plein. Après le départ de l’agent Gourvil en 1909, l’ingénieur propose, pour le service de l’île Noire, en baie de Morlaix, « le ménage Scornet, sur lequel nous avons de très bons renseignements, auxquels nousajoutons cette considération que Madame Scornet est fille du gardien actuel et est déjà très au courant du service ». Un tragique fait divers vient confirmer quelques années plus tard que le service des femmes est généralement très fiable. Sur l’île de Belle-Île, le couple Matelot assure la veille du feu de Kerdonis. Le 18 avril 1911, le mari, Alexandre-Désiré, meurt dans la soirée avant de prendre son service. Aidée par ses enfants, la courageuse veuve parvient à maintenir les 5 éclats rouges toutes les 25 secondes parfaitement visibles sur l’horizon (voir photo en Une).
Le 31 octobre 1983, Gisèle Halimi, alors députée de l’Isère, attire l’attention du secrétaire d’État chargé de la mer sur la situation de ces femmes au regard du Code du travail maritime : il est demandé qu’elles obtiennent un statut de titulaire, ce qui est acté l’année suivante. En 1984, le concours des électromécaniciens est ouvert aux femmes. Elles sont deux en tout et pour tout : Françoise André, nommée électromécanicienne de phare en 1984, est affectée à la station DECCA d’Aurillac, puis au parc de Lézardrieux ; mais dans un phare en mer seulement en janvier 2001 aux Sept-Îles. Avec Sylvie Chalumeau-Brousse, Françoise André est la première des deux seules et uniques électromécaniciennes nommées en France.
Selon le registre des gardiens de phares que le Centre national des Phares termine actuellement, sur les 5 800 noms recensés, 550 sont des gardiennes auxiliaires, soit 1/10e (tout en rappelant qu’aucune n’est officiellement prise en compte avant 1886 !). Si les femmes demeurent largement exclues des services administratifs, il convient de souligner la forte féminisation de la profession étudiée. Les pourcentages sont toujours plus élevés que dans des secteurs traditionnellement considérés comme réservés, tels l’enseignement, la protection sociale ou les Postes et Télégraphes. En revanche, ici aussi elles restent confinées dans des rôles subalternes, d’auxiliaires corvéables, sans sécurité de l’emploi, sans retraite, et pour des salaires bien moindres.


